#15 - Le paradoxe du voyage
Comment repenser le voyage à l'heure du réchauffement climatique ? Et si le voyage faisait finalement partie de la solution...et non du problème ?
Bonjour tout le monde 👋,
C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.
Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion ou lire les épisodes précédents..
🧚 Le mythe du jour : les vraies vacances sont les vacances qui nous emmènent loin.
Pour se reposer l'hiver, il faut partir au soleil.
Passer des week-ends à Rome, Madrid ou Berlin est la marque des curieux, des gens intelligents et ouverts d'esprit.Il suffit de faire trois pas sur le quai d’un métro pour tomber sur ces affiches, toujours les mêmes : du sable blanc, une eau plus bleue que bleue et une injonction en larges lettres blanches : “Répondez à l’appel de la plage”, “mettez les voiles”, “réservez vos vacances d’hiver au soleil”, “cap sur les îles Grenadines”…
Influenceurs, comptes Instagram, blogs de “passionnés de voyage”, guides touristiques, émissions de télé… Notre image idéale des vacances est fortement sous pression et dès qu’on en a les moyens, on se dit qu’il serait temps de se “payer de belles vacances”, de “partir au soleil”.
Et quand on gagne tellement bien sa vie qu’on a même plus le temps de partir ?
Pas de problème, il y a les “week-ends escapades” : le week-end en amoureux à Venise, le week-end shopping à Londres, le week-end détente à Marrakech ou le week-end gourmand à Copenhague.
Comment repenser ce récit ? Est-ce “normal” de partir à l’autre bout du monde pour se baigner ? Doit-on pour autant arrêter de voyager pour préserver la planète ? Et si le voyage faisait finalement partie de la solution et non du problème ?
🎢 C’est reparti pour un snooze.
Sommaire
Les premiers touristes
L’industrialisation du tourisme
95% des touristes mondiaux visiteraient moins de 5% des terres émergées
Voyage romantique vs. voyage humaniste
Du voyage organisé au voyage imposé
Redéfinir notre récit du voyage
Les premiers touristes
Les Homo Sapiens ont évidemment toujours voyagé mais pas vraiment par plaisir.
Pendant longtemps, voyager était une activité dangereuse qu’on envisageait que par obligation : essentiellement pour faire la guerre ou pour faire du business.
Les autres raisons de voyager étaient rares et plutôt mal acceptées. Chevaliers errants, marchands, vagabonds, troubadours, exilés, ceux qui choisissaient la vie nomade étaient souvent considérés avec méfiance.
Il reste encore des traces de cet héritage médiéval. Les gens du voyage sont régulièrement victimes de discriminations et il ne faut pas oublier que le vagabondage était encore un délit en France en 1994 !
Le voyage d’agrément est finalement apparu assez tardivement dans l’Histoire des Hommes. Poursuivant de grands desseins humanistes, certains érudits comme Montaigne partaient déjà en voyage sur les routes d’Europe auparavant mais c’était plutôt rare.
C’est en Angleterre et en Ecosse que se sont institutionnalisées les pratiques du voyage d’agrément que l’on a regroupées, à partir de la seconde moitié du XVIIème siècle, sous l’appellation du Grand Tour. Elles concernaient déjà une étroite élite sociale. A l’issue de leurs études, les jeunes aristocrates britanniques partaient effectuer un long voyage, souvent de deux années.
Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France (2017)
La pratique se répand et dès le XVIIIe siècle, chaque jeune destiné à de hautes carrières se doit d’effectuer son “Grand Tour”. Il semblerait que l’éducation sexuelle faisait aussi partie du programme lors d’étapes à Venise ou en Turquie par exemple.
En France, de grands noms sont passés par là : Montesquieu en 1728, Buffon en 1730, Fragonard en 1756, Condorcet en 1770, le Marquis de Sade en 1775 ou encore Stendhal en 1800.
C’est d’ailleurs à Stendhal que l’on doit l’emploi du mot “touriste” dans ses Mémoires d'un touriste paru en 1838 (mot construit à partir de l’expression “Grand Tour”).
À l’époque déjà, les itinéraires étaient souvent les mêmes. En plus de marquer un certain statut social, le “Grand Tour” permettait de visiter les hauts lieux de l’histoire européenne et de parfaire sa culture classique.
Balisé par des itinéraires essentiellement urbains, l’hiver en Touraine, deux ou trois mois à Rome, six mois à Paris, le grand tour est réservé à une petite élite fortunée. (…) Les jeunes gens découvrent le monde et ses richesses culturelles (avec un ensemble de visites obligées, répertoriées dans des guides, qui forment progressivement un corps de références communes).
Anne Catherine Wagner, La place du voyage dans la formation des élites (2007)
Le but du voyage n’était pas d’aller explorer l’inconnu mais d’aller visiter les sites qui devaient être vus, de se forger une culture commune avec ses pairs.
L’industrialisation du tourisme
L'industrialisation du tourisme débute avec Thomas Cook, qui, en 1841, organise son premier voyage en train à vapeur pour emmener 570 militants de Leicester à un meeting antialcoolique 16km plus loin, à Loughborough, pour un shilling.
En quatre ans, Cook transforme son initiative philanthropique en activité commerciale, proposant des excursions de plus en plus ambitieuses, comme son premier voyage à forfait en 1855, qui inclut transport, hébergement et restauration pour l'Exposition universelle de Paris.
Il lance en 1869 la première croisière sur le Nil et, en 1872, le premier tour du monde organisé. En 1900, Thomas Cook & Son devient le leader mondial du tourisme, annonçant même la vente des premiers billets d'avion en 1919.
Je vous épargne l’histoire du tourisme mais sachez qu’aujourd’hui le secteur représente environ 10% des emplois au niveau mondial et qu’en 1950 on dénombrait 25 millions d’arrivées touristiques internationales contre 1,3 milliard l’an dernier.
Evidemment, ça pose de plus en plus de problèmes. Quelques exemples récents :
Récemment, des barcelonais ont aspergé les touristes avec des pistolets à eau en chantant “Tourists go home” (Barcelone accueille plus de 30 millions de touristes chaque année pour une population d’un peu plus d’un million).
À Fujikawaguchiko, la municipalité a fait installé des filets pour décourager les touristes qui venaient par milliers prendre la même photo du Mont Fuji.
L’office du tourisme de Crozon fait du “demarketing” pour tenter de faire oublier la plage sauvage de l’ile vierge. “On la retire des documents, des itinéraires touristiques, des sites internet, des guides de voyage”.
Le problème du surtourisme, ce n’est pas tellement le nombre de touristes mais plutôt le fait qu’ils décident tous d’aller au même endroit.
95% des touristes mondiaux visitent moins de 5% des terres émergées
C’est une donnée diffusée par l’Organisation Mondiale du Tourisme.
On l’a vu avec les aristocrates européens qui faisaient leur “Grand Tour”, ils suivaient tous le même itinéraire, il y avait des étapes obligées, des sites qui devaient être vus : Paris, Venise, Rome…
Et on ne peut pas dire que cela ait changé, bien au contraire.
Ne voyage-t-on pas après tout pour revoir, reconnaître, vérifier, repasser là où d'autres sont passés, comme si seule comptait l'expérience individuelle, le « voir-de-ses-propres-yeux » (et quand bien même cette expérience serait collectivement inutile) ?
Juliette Morice, Renoncer aux voyages (2024)
En fait, on veut tous aller au même endroit, prendre la même photo et la partager au même endroit.
Un sondage auprès des voyageurs de 18 à 33 ans a même révélé en 2017 que plus de 40% d'entre eux choisissaient leurs destinations de vacances en fonction de leur potentiel "Instagrammable".
Depuis sa conception, le voyage touristique est finalement d’avantage un parcours de vérification qu’une aventure en tant que telle.
La plupart du temps, les voyageurs paient même pour éviter l’imprévisibilité du voyage. Les tour operator promettent “l’assurance d’un voyage inoubliable”, ce qui est assez paradoxal quand on y pense.
Toujours - sauf au bordel - on paie pour que rien n'arrive, pour ne pas dormir à la belle étoile, pour ne pas partager les récits, les délires et les puces d'un dortoir de dockers, pour poser ses fesses - je l'ai fait avant-hier par fatigue - sur le velours inutile d'un compartiment face à des usagers que l'éducation a rendus trop timides pour qu'ils osent ou qu'ils daignent vous adresser un mot.
Nicolas Bouvier, Chroniques japonaises (1975)
Nicolas Bouvier, journaliste-écrivain-voyageur, touche un point intéressant. Avec le “Grand Tour” est peut-être née une nouvelle forme de voyage : le “voyage romantique”.
Voyage romantique vs. voyage humaniste
Auparavant, les rares voyageurs semblaient davantage intéressés par la rencontre que par les visites culturelles, c’était “le voyage humaniste” dont le modèle privilégié serait Montaigne écrit Juliette Morice dans son dernier livre, Renoncer aux voyages.
À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers, non pour en rapporter seulement, à la mode de notre noblesse française, combien a de pas la Santa rotonda, ou combien le visage de Néron, de quelque vieille ruine de là, est plus long ou plus large que celui de quelque pareille médaille ; mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui.
Montaigne, Essais (1580)
Mais avec le “Grand Tour”, l’élite européenne qui veut parfaire une éducation aisée, se doit de partager des valeurs et des idées communes. La culture classique fait partie intégrante du programme et les hauts lieux culturels de l’Europe antique deviennent les cibles principales des voyages.
Le voyage romantique privilégie donc les objets plus que les vivants.
Pendant le repas le chef de la loi m’avait fait faire plusieurs questions par Joseph ; il voulait savoir pourquoi je voyageais, puisque je n’étais ni marchand ni médecin. Je répondis que je voyageais pour voir les peuples, et surtout les Grecs qui étaient morts.
François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811)
Ça tombe bien, les visites de sites sont plus faciles à vendre que les rencontres. Le voyage romantique est une proie facile pour le système marchand. L’engrenage capitaliste classique va pouvoir se développer.
Les destinations deviennent des produits à part entière, où l'expérience est soigneusement façonnée pour maximiser les profits. Les voyageurs sont incités à consommer des souvenirs, des activités et des services. Même les événements historiques sont recréés, rejoués et vendus comme des expériences à vivre.
Le voyage romantique devient le voyage-consommation.
Ces touristes qui partent en car dans le Grand Nord refaire les gestes de la ruée vers l'or, à qui on loue une batte et une tunique esquimaude pour faire couleur locale, ces gens-là consomment : ils consomment sous forme rituelle ce qui fut événement historique, réactualisé de force comme légende.
Jean Baudrillard, La société de consommation (1970)
Du voyage organisé au voyage imposé
Outre le “voyage-consommation”, arrêtons-nous sur un type de déplacement un peu particulier, que j’appellerai le “voyage imposé”.
A mon sens, s’est développée ces dernières années une nouvelle forme de consommation touristique qui nécessite un déplacement, souvent très carboné, même s’il n’est pas souhaité au départ.
La publicité, le cinéma, les cartes postales nous expliquent depuis des années ce que sont les vacances…
Vous commencez à le savoir, les vacances, en toute saison, doivent contenir les ingrédients suivants : soleil, croisières, sable blanc, palmiers, corps bien bronzé et maillot de bain…
Evidemment, quand on habite Boulogne, c’est pas évident. Pas le choix, il faut bien “partir au soleil”.
Les heures de vol qui s’ensuivent ne sont pas tant un voyage qu’une tentative de maîtrise de la nature. Soit la nature environnante a pu être modifiée (par l’installation de canons à neige voire la création de pistes de ski en plein désert) et si tel n’est pas le cas, on s’en va ailleurs.
Comme on l’a déjà vu dans un épisode précédent, beaucoup de récits actuels sont basés sur cette maîtrise de la nature. La nature est une attraction qu’on arrive à contrôler.
Ce n’est plus un voyage organisé, c’est la nature qui est à organiser, on se passerait bien du voyage mais il est imposé par cette nature qu’il faut transformer.
Redéfinir notre récit du voyage
Je pense qu’aujourd’hui, ces deux types de voyage, le “voyage-consommation” et le “voyage imposé” représentent la majorité de nos déplacements touristiques, en avion en tout cas.
Cette représentation du voyage aujourd’hui est particulièrement néfaste pour l’environnement. Le tourisme représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, entretient des crises immobilières, accroit la surconsommation de ressources naturelles, contribue à détruire la biodiversité…
L’objectif que l’on doit se fixer n’est pas de ne plus voyager mais bien de redéfinir notre récit de voyage.
Mais reprenons depuis le début, pourquoi voyage-t-on ?
Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir ; coeurs légers, semblables aux ballons,
De leur fatalité jamais ils ne s’écartent,
Et sans savoir pourquoi, disent toujours : Allons !Charles Baudelaire, Le voyage (1857)
Une force invisible, inexplicable qui nous pousse à nous en aller. Nous serions comme poussés à partir, prendre l’air… Pour quelles raisons ? Un voyage se passe de motifs écrit Nicolas Bouvier :
Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse: Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait.
Nicolas Bouvier, L’usage du monde (1963)
Il suffit de lire quelques récits de voyage (je vous recommande chaudement L’usage du monde de Bouvier) pour comprendre ce qu’on recherche en voyageant.
Le voyage nous sort de notre zone de confort, il nous rend vulnérable, il nous confronte à l’extraordinaire. Il nous questionne sur ce que nous sommes, sur la vie que nous menons, ils nous force à être disponible.
Selon moi, le voyage n’est pas tant une question de kilomètres ou de frontières à passer qu’une question de rythme et de disponibilité. Revenir de voyage, rentrer chez soi avec de nouvelles idées, peu importe l’endroit où l’on est allé.
On peut monter sur un vélo ou prendre un train, on peut aussi partir plusieurs mois au bout du monde, on peut voyager partout tant qu’on résiste au “voyage-consommation” et aux “voyages imposés”.
“Voyage réparateur” ?
A l’heure où notre planète devient de plus en difficile à habiter, où nous avons désespérément besoin de changer de rythme , peut-être que le voyage fait finalement partie de la solution. Repenser notre vision du voyage nous aidera peut-être à repenser notre mode vie.
Dans son livre, Juliette Morice cite une nouvelle de l’écrivain anglais G. K. Chesterton mettant en scène un voyageur sur le départ, en train de faire ses valises dans son appartement de Battersea à Londres. À l’un de ses amis qui lui demande sa destination, il répond qu’il s’en va à… Battersea.
Je n'arrive plus à voir cette porte, ni la chaise juste là, car le voile du sommeil et de l'habitude est sur mes yeux. Le seul moyen de les retrouver est de partir ailleurs. C'est là le seul objet du voyage et le seul plaisir des vacances. Vous vous imaginez sans doute que je vais en France pour voir la France? Que je vais en Allemagne pour voir l'Allemagne ? Je serai très heureux là-bas, mais ce n'est pas ces pays que je cherche, c'est Battersea.
G. K. Chesterton, Tremendous Trifles (1909)
Mais alors on fait quoi ?
Peut-être faudrait il réorganiser le temps de travail de manière à accorder de longues périodes pour voyager lentement, flexibiliser la prise de congés en entreprise pour pouvoir prendre des vacances moins souvent mais plus longues
Développer et encourager le «woofing», qui permet de travailler au sein d’une ferme biologique affiliée au réseau mondial WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms) en échange du gîte et du couvert.
Jeter un oeil aux outils permettant de voyager différemment comme Greengo, Hourrail ou Hexplo
répliquer des initiatives comme celle de la ville de Copenhague dont la campagne CopenPay récompensait les comportement ecofriendly des touristes en offrant des places de musée ou des repas gratuit. Copenhague Pay
Opter pour le Lonely Planet Voyages zéro carbone (ou presque) ou pour les guides recto verso réalisés par Les Others qui proposent de supers cartes de randonnées en France et en Europe
Générique (par ordre d’apparition)
Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France (2017)
Anne Catherine Wagner, La place du voyage dans la formation des élites (2007)
Juliette Morice, Renoncer aux voyages (2024)
Nicolas Bouvier, Chroniques japonaises (1975)
Montaigne, Essais (1580)
François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811)
Jean Baudrillard, La société de consommation (1970)
Le Splendid, Les bronzés font du ski (1979)
Charles Baudelaire, Le voyage (1857)
Nicolas Bouvier, L’usage du monde (1963)
G. K. Chesterton, Tremendous Trifles (1909)
Vous voulez participer ?
Avec plaisir, j’ai besoin de vous pour cliquer sur 🤍, vous abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :
À très vite 👋,
Romain

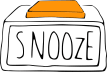





Merci Romain, un temps de lecture pour se replonger dans les voyages passés et se réjouir de ceux à venir... sortir du tout ou rien, cela fait effectivement partie de la solution ;)
Super snooze, j’ai adoré avoir ces nouvelles clefs de lecture notamment entre voyage humaniste et romantique.
Pendant que tu revenais aux sources du Grand Tour, et ses origines dans la noblesse, je n’ai pu m’empêcher de penser que de nombreux autres « tours » précédaient cela, et étaient des voyages humanistes poussant l’éducation.
Dès le XIIIeme siècle s’institutionnalise en France et dans de nombreux pays d’Europe la pratique du compagnonnage (il en reste aujourd’hui les compagnons du Tour de France) https://www.museecompagnonnage.fr/le-compagnonnage/histoire
Le voyage était une partie essentielle de l’artisanat et de son développement