#31 - Prisons : faut-il les fermer… ou les ouvrir ?
On croit qu’il faut enfermer plus de monde, dans des conditions plus dures, pour faire baisser la délinquance. Mais les chiffres prouvent exactement l’inverse. Et si on changeait de récit ?
Hello tout le monde 👋,
C’est Romain de snooze, la newsletter qui décrypte tous les 15 jours un mythe moderne ancré dans notre quotidien.
Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn pour continuer la discussion et lire les épisodes précédents.
J’ai choisi de traiter le sujet des prisons parce qu’une fois de plus, c’est un récit relativement récent dans l’Histoire et qui a beaucoup évolué ces dernières années.
On va le voir, même si les prisons existent depuis des millénaires, la prison moderne, elle, est née au XIXe siècle.
Ces dernières années en France, on a vu apparaître un nouveau récit autour de la prison : en plus d’être un lieu de privation de liberté, la prison doit être aussi un lieu de souffrance pour être efficace.
Entre 2000 et 2018, le taux d’incarcération en France a augmenté de 23% et la France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l’homme pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires.
Pourtant, selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès, la part des français jugeant que les détenus étaient “trop bien traités” est passée de 18% à 50% sur la même période.
La prison ne fonctionne pas mais pour l’opinion publique, il n’est pas envisageable de punir autrement. La prison doit faire souffrir et c’est même assurément cette caractéristique afflictive qui assurerait son efficacité… C’est une idée reçue qu’il faut bien évidemment combattre.
Rapport sur les prisons ouvertes, Observatoire de la justice pénale (2021)
D’où vient cette idée que la prison doit absolument mal traiter et faire souffrir pour être efficace ?
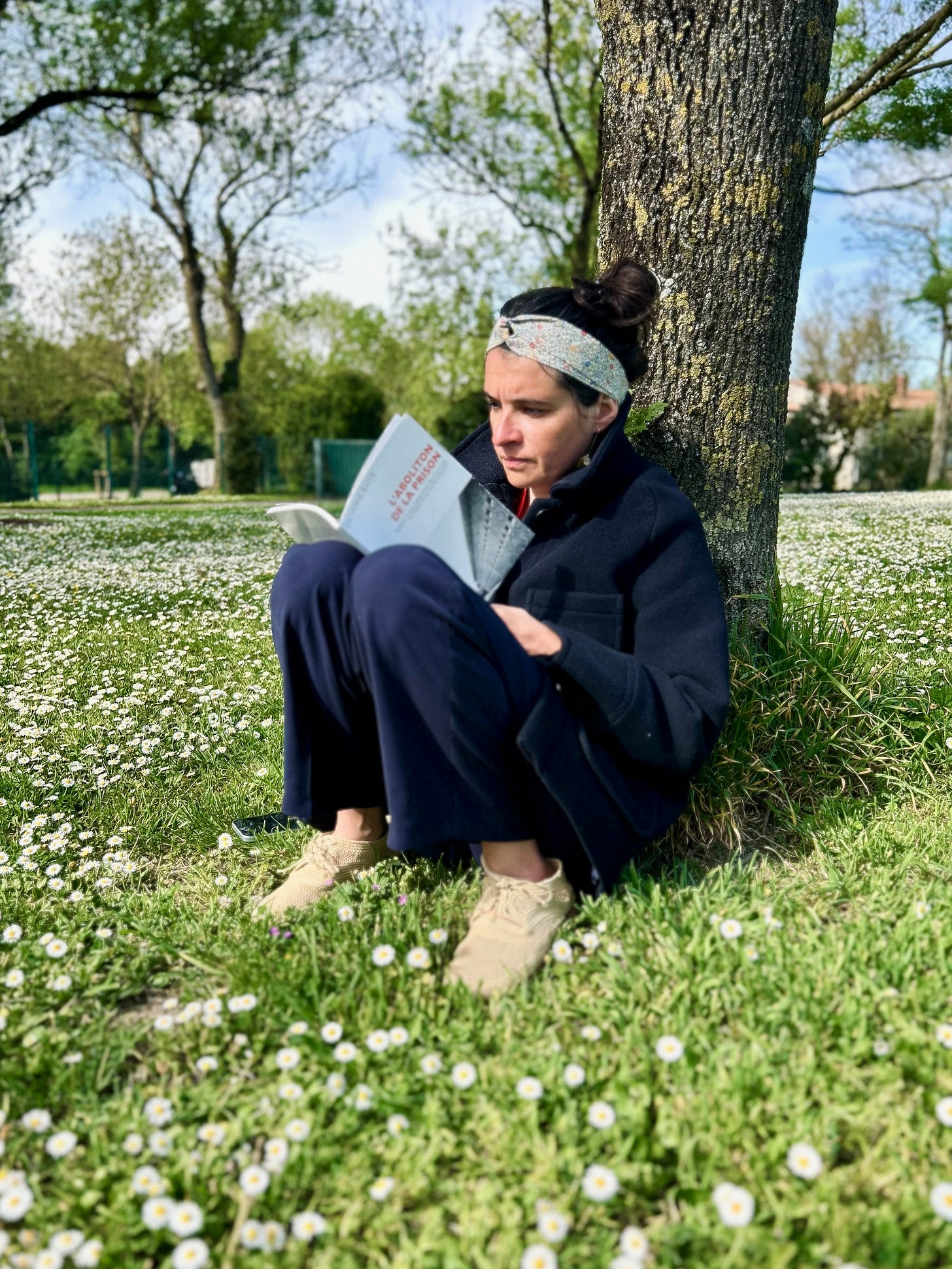
C’est parti !
Sommaire
La prison, une invention récente ?
Des prisons pleines… et une criminalité stable
Les oubliés de la République : qui enferme-t-on vraiment ?
Et si on ouvrait les portes ?
La prison, une invention récente ?
On retrouve des traces de lieux d'emprisonnement à proximité de palais royaux en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans. La plus ancienne prison précisément identifiée est celle de Mamertine, construite au VIIe siècle avant JC à Rome.
Mais à cette époque, et jusqu'à la Révolution Française, la prison est un lieu d'attente pour les prévenus. Un monarque pouvait décider d'y enfermer n’importe qui, le temps qu’un jugement soit rendu ou qu’un châtiment tombe.
Mais, comme souvent, le récit moderne autour des prisons a altéré notre jugement.
Vous connaissez sûrement les “oubliettes”, ces cachots dans lesquels étaient précipités les prisonniers enfermés à perpétuité ?
Pourtant jamais personne n’a été jeté aux oubliettes. Les oubliettes désignaient dans les châteaux forts médiévaux non pas un cachot, mais une réserve de nourriture.
Non, la prison en tant que telle n’était pas une peine, mais une simple mesure préventive.
Les peines étaient exécutées sous forme de supplices. Le corps du condamné était la cible principale de la répression : mutilé, brûlé, pendu, roué en place publique selon une gradation soigneusement orchestrée. L’objectif : frapper les esprits, terroriser, dissuader.
Il faudra attendre les philosophes des Lumières qui, eux, s’interrogent : punir, oui, mais pour quoi faire ? Faut-il vraiment faire souffrir pour corriger ?
Influencés par Cesare Beccaria, les réformateurs du XVIIIe siècle plaident pour une refonte du droit de punir. Le corps n’est plus au centre de la peine. L’idée n’est plus de mutiler, mais de corriger.
Le châtiment est passé d’un art des sensations insupportables à une économie des droits suspendus.
Michel Foucault, Surveiller et punir (1975)
La prison change de nature. Elle devient un espace proprement pénal, inscrit dans les codes. En 1791, la Révolution française codifie pour la première fois l’emprisonnement comme peine en tant que telle.
La prison cherche dorénavant à isoler, à surveiller, à discipliner.
Jeremy Bentham, philosophe anglais, imagine le panoptique : une prison circulaire où les détenus, ne sachant jamais s’ils sont observés, finissent par s’auto-discipliner.
Désormais, ce qu’on cherche à redresser, ce n’est plus le corps, mais l’âme.
Et pour beaucoup de détenus, ce n’est pas tant la cellule qui enferme que le système entier qui, à force de répétition, finit par s’infiltrer dans les esprits.
Ces murs ont un effet bizarre. On les hait d'abord, et ensuite on s'y habitue, et plus le temps passe, plus on finit par en avoir besoin. C'est ça être institutionnalisé.
Les Évadés, Frank Darabont (1994)
Depuis la Révolution française, le recours à la prison n’a cessé de se renforcer. Les peines se sont codifiées et les établissements se sont multipliés.
En 1981, avec l’abolition de la peine de mort, la prison est devenue la peine la plus lourde du système pénal.
Des prisons pleines… et une criminalité pourtant stable
Depuis 1980, le taux d’incarcération en France a augmenté de plus de 60%. Et pourtant, la criminalité, elle, est restée globalement stable.
Chaque année, les services de police et de gendarmerie enregistrent entre 55 et 60 crimes et délits pour 1 000 habitants, un chiffre qui n’a pratiquement pas bougé depuis quarante ans.
Dans ce contexte, la hausse continue du nombre de détenus interroge.
En 1980, on comptait 65 détenus pour 100 000 habitants. En 2025, ce taux a quasiment doublé, atteignant 122 détenus pour 100 000 habitants !
Cette inflation carcérale ne s’explique ni par une explosion de la violence, ni par un effondrement de l’ordre public. Elle relève d’un autre mécanisme, bien documenté par les chercheurs :
Plus on construit, plus on enferme.
Dès lors qu’il y a des cellules disponibles, on y envoie plus facilement les prévenus. On recourt plus systématiquement à la détention provisoire. On prononce davantage de peines fermes. Et les alternatives à l’incarcération restent sous-développées.
Résultat ?
En 2000, un rapport parlementaire décrivait déjà la prison française comme une « humiliation pour la République ».
Vingt ans plus tard, la situation s’est encore dégradée.
Au 1er mai 2025, on compte 83 681 personnes détenues dans les prisons françaises. Le taux d’occupation moyen des maisons d’arrêt est de 163% et 5 234 détenus couchent sur des matelas au sol.
La vétusté des conditions d’hébergement peut en elle-même constituer une réelle maltraitance. [...] En second lieu, c’est l’hygiène qui est compromise, l’aération insuffisante produit une humidité et des moisissures permanentes, l’absence d’isolation interdit que l’on parvienne à une température acceptable en cellule, les douches ne sont pas désinfectées, voire ne fonctionnent pas, il n’y a pas d’eau chaude, la vétusté des toilettes est telle qu’elles ne peuvent pas être nettoyées. Enfin, l’intimité est mise à mal au point que cela peut constituer un véritable traitement indigne.
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d’activité (2022)
La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour des conditions de détention jugées inhumaines et dégradantes.
En mars 2024, c’est même le Comité des ministres du Conseil de l’Europe qui exprime sa « profonde préoccupation » face à une situation qui ne cesse d’empirer.
Il faut rapeller que le taux de suicide dans les prisons françaises est 19,1 suicides pour 10 000 personnes détenues contre une moyenne européenne de 7,1 (soit le troisième taux le plus élevé parmi les 47 pays étudiés).
Et pourtant depuis trente ans, la réponse reste la même : construire !
Plus de places, plus de murs, plus de prisons.

On nous dit que les prisons sont surpeuplées. Mais si c’était la population qui était suremprisonnée ?
Michel Foucault, dans le Manifeste du Groupe d'information sur les prisons (1971)
Les oubliés de la République : qui enferme-t-on vraiment ?
Ce “suremprisonnement” n’est pas seulement le produit d’une logique institutionnelle. Il est aussi alimenté par un discours politique et médiatique omniprésent, qui associe prison, fermeté et efficacité.
Entre 2000 et 2018 la part des français jugeant que les détenus étaient “trop bien traités” est passée de 18% à 50% selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès,
En début d’année, une polémique a éclaté à propos de massages et de soins offerts à des détenus de la prison de Seysses. Choqué qu’on traite convenablement certains détenus, Gérald Darmanin a annoncé que les activités ludiques seraient désormais interdites en prison.
“La prison c’est pas le Club Med” pouvait-on entendre sur CNews…
On tolère d’autant plus facilement l’indignité des prisons qu’elle touche des publics déjà marginalisés.
La violence du système carcéral ne s’exerce pas au hasard : elle frappe plus durement les plus précaires et les plus isolés. Ceux qui n’ont ni réseau, ni avocat, ni capital scolaire :
Environ 85 % des détenus ne dépassent pas le niveau CAP et 16 % sont en situation d’illettrisme.
l’absence d’emploi multiplie par 1,5 la probabilité d’une peine d’emprisonnement ferme
un prévenu qui touche moins de 300 € par mois a trois fois plus de chances d’être condamné à du ferme que quelqu’un qui gagne 1 500 € ou plus.
Être né à l’étranger ou sans domicile fixe multiplie par trois les chances d’être jugé en comparution immédiate et par cinq d’être placé en détention provisoire.
Ce n’est pas lié à de la discrimination directe des juges mais au fait que ces publics défavorisés se défendent moins bien : ils ne sont pas systématiquement présents au procès, ne sont pas suffisamment bien représentés, ne sont pas soutenus par leurs proches le jour du procès (ce qui joue sur la décision), n’adoptent pas la bonne attitude face au juge…
Et une fois en prison, ceux-là ne perdent pas seulement leur liberté. Ils perdent aussi d’autres droits fondamentaux :
droit du travail : les détenus sont rémunérés entre 20 et 45% du Smic, ils ne peuvent pas se syndiqués, ils ne bénéficient pas de congés payés…
protection sociale : les allocations chômage s’interrompent après 15 jours de détention, le RSA après 60 jours de prison.
droit de vote : depuis le 4 juin 2025, les détenus ne peuvent plus voter par correspondance aux élections locales, une mesure qui avait pourtant permis de passer de 1% de votants aux législatives des 2017 à 20% en 2024.
Et si on ouvrait les portes ?
Le récit moderne veut nous convaincre que la prison serait efficace uniquement si elle mal-traite les détenus, les prive de leurs droits fondamentaux. Ce serait à ce prix qu’elle dissuaderait les délinquants…
Est-ce vrai ?
Rappelons que toute peine a, en théorie, trois objectifs :
Compenser une faute (fonction de rétribution)
Dissuader de recommencer (fonction de prévention)
Rééduquer le condamné (fonction de rééducation)
L’info à retenir absolument, c’est que la prison, en France, échoue totalement dans son rôle de prévention et de rééducation puisque 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans.
En réalité, pour pouvoir se réinsérer et ne plus être une menace pour la société, les détenus devraient pouvoir travailler, participer à des activités, tisser à nouveau un lien avec la société.
C’est exactement le projet des “prisons ouvertes”, une autre conception de la prison qui s’est imposée dans les pays scandinaves.
En Finlande par exemple, les détenus peuvent candidater, s’engager à respecter des règles strictes et intégrer une des 26 prisons ouvertes du pays : pas de mur, pas de mirador, pas de barreaux aux fenêtres.
La discipline repose sur la responsabilité du détenu plutôt que sur la surveillance permanente.
À Suomenlinna par exemple, les détenus peuvent se promener librement, un GPS accroché à la cheville. Ils peuvent prendre le bateau pour aller travailler ou pour faire des courses dans la capitale.

Les résultats sont bluffants :
En Finlande, les prisons ouvertes concernent un détenu sur trois et le taux de récidive est 20% inférieur à celui des prisons classiques
au Danemark, 25% des détenus sont dans des «prisons ouvertes», le taux de récidive dans les cinq ans est de 25% (vs. 63% en France)
La prison, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, est inefficace, inégalitaire, et indigne. Elle ne dissuade pas, elle désocialise, elle abîme et les solutions (plus justes, plus humaines, et plus efficaces) existent ailleurs.
Et en plus, ça coute moins cher ! Un détenu en prison ouverte en Finlande coûte 116€ par jour (contre 200 euros en prison fermée).
Comme les autres récits que je traite dans snooze, le récit moderne des prisons semble profondément ancré. Mais en réalité, il est très récent !
On peut donc légitimement penser qu'il peut se transformer tout aussi rapidement.
Comment renverser l’imaginaire de la peine ? Sommes-nous prêts à reconnaître que souvent, un détenu n’est pas un ennemi public à faire souffrir, mais un citoyen à reconstruire Comment convaincre que réinsérer, ce n’est pas excuser, c’est protéger la société durablement ?
Une fois de plus, nous sommes prisonniers d’un récit que d’autres nous imposent :
Le ciel vous regarde derrière les barreaux de sa prison. Qui vous garantit que c'est vous qui êtes à l’intérieur et lui à l'extérieur ? Il se peut que ce soit le contraire. Essayez donc de voir les choses ainsi.
Iakovos Kambanellis, Mauthausen (1963)
Tu veux m’aider ?
Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour cliquer sur 🤍, t’abonner ou partager cet article. Ça m’aide beaucoup à faire connaître mon travail :
Abonné
À très vite 👋,
Romain







Très intéressant, ça donne envie de mieux comprendre les autres systèmes de prévention/ rééducation à travers le monde, notamment le concept de prison ouverte.
Très intéressant. Dans le discours populaire on entend aussi souvent "il faudrait rétablir la peine de mort !". Tu as une étude sur le taux de récidive des détenus dont les pays dispose toujours de la peine de mort et qui ont écopé de la peine maximum ?