#8 - Le marché, une réalité universelle ?
Le récit d'une construction sociale qui a façonné nos sociétés.
Bonjour les amis 👋,
C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.
🧚 Le mythe du jour : l'universalité du marché
"l’économie de marché est aujourd’hui sans concurrence ! Après un long combat, elle a gagné par KO (...). Son principe est simple, mais a fait ses preuves sous toutes les latitudes : la concurrence permet de produire au moindre coût pour vendre au meilleur prix et satisfaire une part croissante des désirs humains. Le marché est aujourd’hui une réalité universelle. (...)
Malgré bien des aléas, l’histoire économique apparait ainsi comme celle de la diffusion progressive des mécanismes de marché à l’ensemble de l’économie mondiale. (...) C’est ce progrès qui a permis à un nombre croissant d’êtres humains de bénéficier à leur tour des avantages de la croissance économique."
Extrait de l'article "Economie de marché" sur le site du ministère de l'économie et des financesPetite revue de presse Google Actualité en ce début de semaine :
Immobilier, la loi du marché
Les marchés poursuivent leur marche en avant
le RC Lens met deux joueurs sur le marché !
Sanofi : le marché apprécie les nouveaux investissements massifs en France
L’Eurovision fait 36,8 % de parts de marché
Braslou : le marché aux asperges c'est dimanche
Après un fléchissement du marché de l'art en 2023 les maisons d'enchères lancent leurs ventes de printemps
Le marché des tablettes retrouve timidement le chemin de la croissance…
Que l’on parle de sport, d’art, de santé, de finance, d’asperges ou d’électronique, les marchés sont aujourd’hui partout. Est-ce que ça a toujours été le cas ? De quand date cette construction sociale qui nous semble aujourd’hui immuable ? Quelles sont les conséquences sur nos comportements et nos modes de vie ?
💪 On y va
Au Sommaire
99% de l’humanité n’a pas connu le marché
Pendant 5 000 ans, des échanges mais pas de marché
L’avènement d’un nouveau récit : la société de marché
Le marché force-t-il l’Homme à maximiser son intérêt personnel ?
99% de l’humanité n’a pas connu le marché
C’est ce qu’affirme l’anthropologue David Graeber dans son livre “La fausse monnaie de nos rêves” (2022). On oublie souvent qu’il y a deux siècles, la plupart des français (et des autres aussi d’ailleurs) vivait presque sans argent. L'économie marchande n'était qu'un phénomène marginal, principalement réservé aux classes privilégiées qui avaient les moyens d'acheter des produits artisanaux.
Aux siècles d’Ancien Régime, entre 1400 et 1800, il s’agit là encore d’une très imparfaite économie d’échange. Sans doute, par ses origines, se perd-elle dans la nuit des temps, mais elle n’arrive pas à joindre toute la production à toute la consommation, une énorme part de la production se perdant dans l’autoconsommation, de la famille ou du village, n’entrant pas dans le circuit du marché.
Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (1985)
Au sein de la communauté, la production pouvait être stockée pour un usage personnel ou familial, échangée (don) ou alors centralisée puis redistribuée. C’est ce qu’explique l’économiste et anthropologue hongrois, Karl Polanyi dans son livre le plus célèbre :
On peut affirmer, en gros, que tous les systèmes économiques qui nous sont connus jusqu'à la fin de la féodalité en Europe occidentale étaient organisés selon les principes soit de la réciprocité ou de la redistribution, soit de l'administration domestique, soit d'une combinaison des trois.
Karl Polanyi, La grande transformation, 1945
Si les marchés impliquant des échanges libres et réguliers de biens et de services contre de l'argent étaient pratiquement inexistants jusqu’au XVIIIe siècle, on ne peut nier que le commerce, lui, existe bien depuis 5 000 ans.
Pendant 5 000 ans, des échanges mais pas de marché
Dans les anciennes cités mésopotamiennes, les temples et palais jouaient un rôle central dans la régulation du commerce. Ils contrôlaient les prix, les marchandises et même les marchands.
C’était une activité intrinsèquement liée à la force militaire et au pouvoir : compétition acharnée pour le contrôle des routes commerciales et des ressources, piraterie, caravanes armées, trafic…On ne peut pas dire que les échanges se faisaient librement, selon la loi de l’offre et de la demande.
On était loin du paiement sans contact 😏.
Il ne s’agissait pas vraiment d’individus s’échangeant des marchandises sur un marché local mais plutôt de collectivités (cités, villes, empires…) qui, à travers un commerce de long court, échangeaient des butins de guerre.
Au Moyen-Âge, ce n’était pas très différent. Le seigneur décidait des dates de marché, des produits qui pouvaient y être vendus, et souvent même des prix. Comme durant l’antiquité, ces marchés et foires étaient axés sur des produits spécifiques, souvent de luxe, destinés principalement aux élites. Les foires internationales, telles que les foires de Champagne, restaient des événements relativement isolés de l'économie quotidienne des populations locales.
Ces foires étaient également le moyen pour le pouvoir de prélever des taxes et d’alimenter ses finances. Avec le développement du mercantilisme au XVIIe siècle, l'État commence à structurer activement les marchés pour maximiser ses recettes fiscales.
L’avènement d’un nouveau récit : la société de marché
Mais c’est bien au XVIIIe siècle qu’un grand bouleversement se produit, un nouveau récit autour du marché va s’écrire : le marché va devenir le système politique dominant.
Jusqu’alors, on peut simplifier en disant que l’ordre religieux régissait le monde et ses hiérarchies. Mais depuis la fin de la Renaissance, la grande question de l’époque moderne était justement de savoir comment penser une société sans Dieu.
Les grands philosophes des Lumières, notamment Montesquieu (De l'esprit des lois, 1748) et Rousseau (Du contrat social, 1762) se sont emparés de cette question pour proposer un certain nombre de lois ou de contrats qui auront un impact politique fondamental.
Charles Louis et Jean-Jacques sont dans tous les manuels scolaires mais c’un outsider dont on parle moins qui va gagner le match : Adam Smith (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776).
Pour Smith, ce qu’il faut pour organiser une société ce n’est pas un contrat passé entre les citoyens, mais un marché : une organisation autorégulée qui réalise des ajustements automatiques et des redistributions. Smith appelle de ses voeux la société de marché :
Un véritable changement du monde humain se profilait ainsi pour lui dans cet avènement d’une société de marché. A l’ère des autorités dominatrices allait succéder, espérait-on, celle du règne de mécanismes neutres (ceux de l’échange), le temps de l’affrontement entre les grandes puissances s’effaçant et cédant la place à une période de coopération entre des nations commerçantes. (…) C’est bien en comprenant la société civile comme marché que Smith a révolutionné le monde.
Pierre Rosanvallon, le capitalisme utopique (1979)
À l’approche des élections européennes, on peut d’ailleurs rappeler qu’avant de créer une union politique, on a commencé par créer un marché commun. Là encore, c’est bien le marché qui fonde le projet politique 🇪🇺.
Après Smith, le marché s’étend au-delà de la noblesse et de la bourgeoisie pour englober l'ensemble de la nation. Le citoyen cher à Rousseau devient consommateur et peu à peu l’Etat fait en sorte que le marché s’étende et transforme en marchandises des éléments non destinés au marché (le travail, la terre et la monnaie). La société de marché se transforme alors en économie de marché, c’est “la grande transformation” :
Jusqu'à notre époque, les marchés n'ont jamais été que des éléments secondaires de la vie économique. En général, le système économique était absorbé dans le système social. (…) Le marché autorégulateur était inconnu : l'apparition de l'idée d'autorégulation représenta en vérité un renversement complet de la tendance qui était alors celle du développement. C'est seulement à la lumière de ces faits que l'on peut vraiment comprendre les hypothèses extraordinaires sur lesquelles repose une économie de marché.
Karl Polanyi, La grande transformation (1945)
Aujourd’hui, la société de marché s’est tellement étendue, l’économie de marché a pris une telle ampleur que certains défendent l’idée qu’en voulant organiser et réguler une société sans dieu, le marché l’aurait finalement remplacé :
Comme la religion publique romaine, le culte des Marchés n’a pas de nom particulier. L’une et l’autre ont en commun d’être acceptés de leurs contemporains comme une évidence, une nécessité rationnelle propre à garantir la survie et la richesse de la société. Or ce qui va de soi n’a pas besoin d’être nommé. Cependant, il est malcommode de discourir sur quelque chose qui n’a pas de nom. Aussi nous baptiserons le culte du Marché de son nom naturel. À partir de la racine grecque agora-(le marché, la foule, la place), nous formons le terme agorathéisme.
Stéphane Foucart, Des marchés et des dieux (2018)
L’agorathéisme, comme toute religion, se caractérise par :
des lieux de culte : Stéphane Foucart remarque que la plupart des bourses du monde ressemblent à des églises ou à des temples.
une confiance aveugle : “il faut croire au marché”, “c’est la loi du marché”, “le marché a toujours raison”… En 2016, au Monde qui l’interrogeait sur son salaire mirobolant, Zlatan répondait “Mais c’est le marché qui décide des prix et non la passion ou les médias. Et si c’est « beaucoup » ou pas, ce n’est pas mon problème. Mon souci, c’est de voir ce que dit le marché. Le marché dit : « Ça, c’est votre prix. Voici ce que dit le marché. »”
une foi collective qui détermine l’humeur du dieu : lorsque les liquidités affluent vers les marchés, les indices montent et les dieux sont contents, lorsque les sacrifices diminuent, la confiance s’écroule et les dieux sont en colère
un clergé : la “finance” (banques centrales, agences de notation…) est une catégorie de la population qui ne produit rien mais qui jouit d’un statut social élevé par sa relation privilégié avec le marché, sa capacité à anticiper ses humeurs et annoncer les sacrifices nécessaires.
un calendrier : comme le christianisme qui a emprunté les principales dates du calendrier païen, le marché s’est accaparé certaines dates de notre calendrier. ThanksGiving, Noël, Black Friday sont des jours où on le célèbre en consommant à outrance.
des fidèles : des consommateurs prêts à sacrifier leur ressources (temps, argent) pour satisfaire les dieux. Fidèles que la théologie économique a transformés en “être rationnel”, en “homo œconomicus” pour nous rassurer.
Le marché force-t-il l’Homme à maximiser son intérêt personnel ?
Le site du ministère prétend que “le marché permet de produire au moindre coût pour vendre au meilleur prix et satisfaire une part croissante des désirs humains.” Mais l’Homme est-il par nature un être économique rationnel, un “homo œconomicus” qui a toujours cherché et qui cherchera toujours à maximiser son intérêt personnel ?
Voici une anecdote intéressante rapportée par l’anthropologue américain Robert A. Brightman dans son article Grateful Prey: Rock Cree Human-Animal Relationships (1993) :
En 1749, l'Angleterre connaissait une forte demande de fourrure. Face à une pénurie croissante, les parlementaires ont examiné les conditions du commerce de la fourrure, particulièrement avec les Cris, une tribu de la Baie d'Hudson.

Au cours de cette réflexion, la décision fut prise de doubler les prix offerts pour les fourrures dans l'espoir d'inciter les Cris à intensifier leur chasse. Comme tous les êtres humains, les Cris chercheront à maximiser leur profit et fourniront ce faisant davantage de fourrures.
Mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Non seulement les Cris n'ont pas augmenté leur production de fourrures mais ils l'ont même divisé par deux. Ils avaient “calculé” qu’ils pouvaient désormais gagner autant d’argent qu’avant en tuant deux fois moins de castors !
Ça me rappelle un extrait de Walden, le magnifique bouquin d’Henry David Thoreau, le philosophe et naturaliste américain qui a vécu deux ans dans les bois :
Le prix d’une chose, c’est la quantité de ce que j’appellerai vie qu’on doit donner en échange, sur-le-champ ou plus tard
Henry D. Thoreau, Walden (1854)
Si les Cris n’étaient pas des “homo œconomicus”, peut-on conclure que l’Homme est un être rationnel qui cherche à maximiser son profit ? L’Homme est-il un être tyrannisé par son cerveau (son fameux striatum) qui exige toujours plus, comme l’a écrit récemment Sébastien Bohler dans son best-seller “le bug humain” (2019) ?
Il me semble intéressant aujourd’hui de s’interroger sur ce récit et son influence sur notre mode de vie actuel : si ce n’est pas l’Homme qui est programmé pour en vouloir toujours plus, peut-être est-ce le fonctionnement du marché, le récit dominant porté par le marché qui pousse l’Homme dans cette voie ?
Générique (par ordre d’apparition)
David Graeber, La fausse monnaie de nos rêves (2022)
Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme (1985)
Karl Polanyi, La grande transformation, 1945
Montesquieu, De l'esprit des lois, (1748)
Rousseau, Du contrat social (1762)
Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776)
Pierre Rosanvallon, le capitalisme utopique (1979)
Stéphane Foucart, Des marchés et des dieux (2018)
Zlatan ⚽️
Robert A. Brightman, Grateful Prey: Rock Cree Human-Animal Relationships (1993)
Henry D. Thoreau, Walden (1854)
Sébastien Bohler, le bug humain (2019)
Ensuite ?
Tu veux participer ? Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour :
t’abonner :
liker, partager et parler de ce post autour de toi :
me dire en commentaire comment tu as trouvé cet article, ça m’aide beaucoup pour les suivants… 👇
À très vite 👋,
Romain

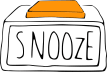




La loi du marché. Je suis en train de lire un livre de Vandana Shiva « mémoires terrestres ». Elle y aborde la loi de la nature. Elle mentionne le rendement de nos économies de marché, mais à quel prix pour la vie , la nature et l’humain ?
Passionnant cet exemple avec les Cris. Le passage de la croissance pour la croissance a la prospérité.