#7 - le mythe de l’entrepreneur visionnaire
Qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Est-il vraiment un génie solitaire qui révolutionne le monde à lui seul ? Est-il le produit de son environnement, de son époque et de ses réseaux ?
Bonjour tout le monde 👋,
C’est Romain de snooze, le mail qui tente, tous les 15 jours, de décrypter un mythe, une représentation bien ancrée dans notre quotidien et dont on dit parfois “qu’est ce que tu veux, c’est comme ça, on a toujours fait comme ça…”, bref on snooze.
🧚 Le mythe du jour : l'entrepreneur visionnaire
"An entrepreneur is not a person who starts a company but he is the person who actually solves a problem. It's all about execution and it is a state of mind. A person who sees a problem is a Human Being, person who finds a solution is visionary and the person who goes out and does something about it is an entrepreneur."
ForbesAndrew Carnegie, John Davison Rockefeller, Henry Ford, Bernard Tapie, Steve Jobs, Xavier Niel, Elon Musk… Depuis la fin du XIXe siècle, la figure de l’entrepreneur s’est fait une place à part dans nos panthéons nationaux.
Le plus souvent, ils sont perçus comme des êtres visionnaires, des self-made men qui inventent à partir de rien, des créateurs… D’où vient ce récit ? Que dit-il de notre société ? Dans ce nouveau snooze, je vais tenter de comprendre comment la représentation sociale de l’entrepreneur imprègne nos imaginaires.
Sommaire
Le récit de l’entrepreneur rebelle, isolé et visionnaire
Un récit sciemment construit et décliné
Les principaux facteurs de succès
Pourquoi ce récit est-il si tenace ?
L’entrepreneur rebelle, isolé et visionnaire
À 24 ans, je me suis lancé dans la création d’une entreprise tech. Cette aventure allait durer dix ans, mais à l’époque - ça devait être fin 2009 - ce n’était qu’un stage de fin d’études. Je retrouvais mes deux associés dans un bureau mis à disposition par un incubateur parisien. Je me souviens encore qu’on avait collé aux murs des citations imprimées sur des feuilles A4 : « Why join the navy if you can be a pirate? », « Whatever you’re thinking, think bigger », « Fake it Till you Make it », « Invent the Future », « Change the world. Build a business. Have fun »…
Ces citations s’échangeaient au sein de notre incubateur et plus largement dans la communauté web. Les stars de la Silicon Valley s’exposaient en héros sur nos murs d’entrepreneurs adolescents. Certains soirs, on se retrouvait même pour suivre en direct les keynote de Steve Jobs. Mais pourquoi 🤷♂️ ?
Je ne vais pas retracer l’histoire de la figure de l’entrepreneur mais pour résumer, le premier à l’avoir théorisé est Jean-Baptiste Say, au début du XIXe siècle. Il définissait l'entrepreneur comme un simple agent de liaison entre la science et l'industrie. Plus tard, Schumpeter a défini l'entrepreneur non plus comme un coordinateur efficace mais comme un révolutionnaire économique capable de défier l'ordre établi et de générer de nouvelles dynamiques de marché.
“ L’entrepreneur est celui qui détruit l’ordre ancien en introduisant un nouvel ordre. “
Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique (1912)
Les entrepreneurs deviennent alors des révolutionnaires, des rebelles. Cette image va s’installer durablement. Souviens toi par exemple de Steve Jobs qui se définissait comme un “pirate” ou de The Family qui avait créé une série de conférences intitulée “les barbares attaquent…” Ce récit de l’entrepreneur révolutionnaire est aujourd’hui très ancré dans les media, où l’on oppose souvent l’entrepreneur visionnaire aux banquiers- rentiers du capitalisme qui sont là pour faire du profit. C’est la fameuse opposition entre Bill Gates et Steve Jobs, d’ailleurs entretenue par ce dernier jusqu’à sa mort :
“ Bill aime se définir comme un homme de produits, mais c'est faux. Bill est un homme d'affaires. Gagner des parts de marché était plus important pour lui que réaliser des chefs d'oeuvres. Au final, il est devenu l'homme le plus riche du monde, et si tel était son objectif, il l'a atteint. Personnellement, cela n'a jamais été mon but.”
Steve Jobs cité par Walter Isaacson (2011)
Le story-telling des médias et des entrepreneurs eux-même a transformé l’entrepreneur schumpeterien en une sorte de génie prométhéen, qui crée à partir de rien et qui apporte la connaissance aux hommes, un « rebelle isolé et créatif » comme le dit Philippe Mustar.
Un récit sciemment construit et décliné
Anthony Galuzzo a étudié, dans son dernier livre, la façon dont se construit et s’entretient ce récit. Il a repéré dans ces histoires 4 schémas, 4 vérités premières :
la précocité : des capacités hors-normes dès le plus jeune âge
la fêlure originelle : une découverte, une motivation cachée (Steve Jobs a été abandonné à la naissance)
les origines modestes : c’est souvent lié dans le récit à des capacités autodidactes
la rébellion fondatrice : une première expérience ratée, des études abandonnées, une révélation…
“ Des chercheurs ont relevé la présence de ces topoï dans des récits dédiés d'autres entrepreneurs, comme Jack Welch, John Chambers, Tony O'Reilly ou Richard Branson. On les retrouve également dans les biographies d'entrepreneurs du début du siècle (Henry Ford, Louis Renault), dans celles de musiciens (Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven), d'hommes de science (Isaac Newton, Albert Einstein), de héros nationaux (Benjamin Franklin, Napoléon Bonaparte) ou plus récemment de stars (Michael Jackson, Marlon Brando). “
Anthony Galuzzo, le mythe de l’entrepreneur (2023)
Ce schéma est maintenant repris par de nombreux entrepreneurs qui tentent de reprendre à leur compte ce récit, de rejouer le mythe originel. A une époque toutes les startups se créaient dans des garages. Avec mes associés, on avait décliné ce récit et le garage était devenu un T2. Malin…
L’entrepreneur se doit de raconter une histoire forte pour convaincre : celle du self-made man précoce, blessé et rebelle face au système est la plus largement répandue. Cet art de raconter des histoires (le fameux pitch) est maîtrisé, répété, rejoué et même « vu à la télé » en prime-time sur M6.
Questionner le récit de l’entrepreneur rebelle, isolé et créatif ne remet pas en cause le rôle, l’engagement et l’importance des entrepreneurs en général. Mais il faut être conscient des facteurs qui facilitent la réussite : comme tous les êtres sociaux, les entrepreneurs sont des êtres situés.
Les principaux facteurs de succès
Steve Jobs n’a pas inventé l’iPod, debout, seul, l’air pensif au milieu d’un grand vide. De nombreux facteurs y ont contribué, les événements nécessaires à la réussite sont multiples, par exemple :
Le rôle de l’Etat
Loin de l'image d'un secteur privé innovant dans son coin, il est plus honnête de reconnaître le rôle de l'État dans le développement des technologies avancées. Mariana Mazzucato, professeure d’économie à l’University College de Londres, a montré que l'État n’était pas seulement un financeur de la recherche fondamentale, mais aussi un preneur de risques essentiel dans les phases initiales, où l'incertitude est la plus forte. Les acteurs privés interviennent généralement plus tard au moment de la commercialisation. Le tactile, la molette cliquable, le multi-touch sont des technologies intégrées par Apple mais qui ont, auparavant, bénéficié de lourds investissements étatiques et notamment militaires dans la Silicon Valley.
Dans “The Entrepreneurial State” (2013), Mariana Mazzucato raconte un déjeuner à San Francisco en 1984 lors d’une visite de François Mitterrand. L’investisseur Thomas Perkins louait au président français les mérites des fonds d’investissement prenant des risques pour financer les entrepreneurs de la Biotech. Paul Berg, prix Nobel et professeur à Stanford, l'a alors interrompu : “Et où étiez-vous dans les années 50-60 quand il fallait financer la recherche fondamentale ? La plupart des découvertes qui ont propulsé l'industrie ont été faites à cette époque grâce aux financements publics”.
Le contexte
Dans son livre « Outliers » (2008), Malcolm Gladwell souligne également que le timing est crucial dans le succès entrepreneurial. Il fait remarquer que de nombreuses figures emblématiques de la microinformatique aux Etats-Unis sont nés entre 1953 et 1956 : Bill Gates (1955), Paul Allen (1953), Steve Ballmer (1956), Steve Jobs (1955), Éric Schmidt (1955), Bill Joy (1954), Scott McNealy (1954), Vinod Khosla (1955),Andy Bechtolsheim (1955)… En 1975, ayant autour de 20 ou 21 ans, ils étaient parfaitement positionnés pour saisir les opportunités émergentes de la microinformatique, ni trop jeunes ni trop installés.
Historiquement, on retrouve ce phénomène au XIXe siècle :
“Ceux qui sont nés dans les années 1820 étaient trop vieux. Mais il y a eu un créneau particulier de neuf ans, au milieu du XIXe siècle. Et selon les historiens, c’est dans cette période qu’on retrouve 20 % des plus grandes richesses de toute l’histoire de l’humanité, toutes américaines : John D. Rockefeller (1839), Andrew Carnegie (1835), Frederick Weyerhaeuser (1834), Jay Gould (1836), Marshall Field (1834), George F. Baker (1840), Hetty Green (1834), etc.”
Anthony Galuzzo, le mythe de l’entrepreneur (2023)
Le capital social
Dans leur ouvrage “La légende de l'entrepreneur” (1999), les chercheurs Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis se sont inspirés des travaux de Pierre Bourdieu et ont décomposé le capital social dont certains entrepreneurs ont la chance de bénéficier :
capital financier : patrimoine personnel, accès au crédit, au capital risque
capital-connaissance : diplômes, connaissances, formation…
capital-relations : réseau d’anciens, relations familiales…
Mais le récit de l’entrepreneur rebelle et visionnaire est tellement ancré dans notre imaginaire que la plupart des entrepreneurs ne veulent pas s’en détacher. On entend souvent des entrepreneurs remettre en cause ou minimiser les influences extérieures. Ils se sentent obligés de satisfaire au mythe du self-made man, de raconter que s’ils ont réussi c’est uniquement grâce à leur travail, que seule la volonté et la determination les ont mené au succès.
Mais alors pourquoi ce récit est-il si tenace ?
Le mythe de l’entrepreneur rebelle et visionnaire est abondamment repris. Les media, les livres de développement personnel, les politiques… Ce récit est un corollaire de deux autres récits au coeur de nos sociétés occidentales :
Nous sommes tous des self-made men : les riches comme les pauvres sont les seuls responsables de leur destin. Nous partageons un même espace, le marché et nous jouons selon les mêmes règles.
La technologie va nous sauver : en bouleversant l’ordre établi, en faisant advenir l’innovation et le progrès, les entrepreneurs vont nous sauver.
Encore une fois, mon point n’est pas de dévaloriser les entrepreneurs mais de mieux définir leur place et leur succès. L’entrepreneur ne vit pas dans une citadelle coupée du monde, il doit avoir conscience des récits et des constructions qui le déterminent.
Je suis sûr qu’il existe de grands entrepreneurs qui n’ont pas pu le devenir, comme monsieur Hamil dans le roman de Romain Gary, cet émigré algérien, ancien marchand de tapis qui enseigne le Coran et Victor Hugo à Momo :
“ Monsieur Hamil est un grand homme, mais les circonstances ne lui ont pas permis de le devenir. ”
Romain Gary, La vie devant soi (1975)
On dit souvent que tel ou tel entrepreneur a réussi mais c’est en réalité ses entreprises qui ont réussi. De l’argent public, des infrastructures, des équipes, des réseaux, de la chance… il faut tout un village pour élever un enfant. Le récit de l’entrepreneur rebelle, isolé et visionnaire est fallacieux. Il n’y a pas de self made man, on se fait toujours avec les autres ou contre les autres :
“ Monsieur de Rubempré arrive d’Angoulème, il aura sans doute besoin de votre protection auprès de ceux qui mettent ici le génie en lumière. Il n’a pas encore d’ennemis qui puissent faire sa fortune en l’attaquant. ”
Illusions perdues, Honoré de Balzac (1837)
Porter une lumière nouvelle sur le récit de l’entrepreneur rebelle et visionnaire c’est interroger les constructions, démultiplier les façons d’entreprendre, ne pas réduire l’entrepreneuriat ni la réussite à une définition unique et aussi faire en sorte que les circonstances permettent à tous les entrepreneurs de le devenir.
Générique (par ordre d’apparition)
Joseph Schumpeter, Théorie de l’évolution économique (1912)
Walter Isaacson, Steve Jobs (2011)
Philippe Mustar, L'entrepreneur schumpeterien a-t-il jamais existé ? (1994)
Anthony Galuzzo, le mythe de l’entrepreneur (2023)
Danny Boyle, Steve Jobs (2015)
Mariana Mazzucato , The Entrepreneurial State (2013)
Malcolm Gladwell , Outliers (2008)
Sophie Boutillier et Dimitri Uzunidis, La légende de l'entrepreneur (1999)
Romain Gary, La vie devant soi (1975)
Illusions perdues, Honoré de Balzac (1837)
Ensuite ?
Tu veux participer ? Avec plaisir, j’ai besoin de toi pour :
t’abonner :
liker, partager et parler de ce post autour de toi :
me dire en commentaire comment tu as trouvé cet articule, ça m’aide beaucoup pour les suivants… 👇
À très vite 👋,
Romain

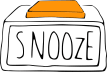




Super intéressant, merci pour cet article. C'est clair que les grands entrepreneurs (Steve jobs, Musk, ...) ont un facteur temporel ultra important pour atteindre de tels niveaux de succès, mais si on analyse la psychologie d'un entrepreneur, on ne peut pas omettre la mentalité rebelle pour tenter de nouvelles choses (ou même simplement le fait de ne pas suivre la moyenne en faisant un métier classique)
En tout cas, tres chouette article, tu as gagné un nouvel abonné 😊!
Très juste. Ce mythe de l'entrepreneur solitaire et visionnaire peut aussi pousser aux vanity metrics et à construire des egos démesurés chez ceux qui y croient.
Merci pour le décryptage.